L’hydrogène : un vecteur énergétique d’avenir
Avis d'experts
26 janvier 2021
L’hydrogène : une filière prometteuse
L’hydrogène (H2) est un des 92 éléments naturels composant l’univers. C’est le premier sur le tableau périodique de Mendeleïev. Son appellation correcte est dihydrogène car sa molécule est constituée de deux atomes d’hydrogène et par simplification, nous l’appelons communément « hydrogène ».
C’est le principal composant des étoiles et des planètes gazeuses faisant de lui l’élément chimique le plus abondant de l’univers. On estime aujourd’hui que 75% de l’univers est composé d’hydrogène en masse et plus de 90% en nombre d’atomes.
Il est aussi très présent sur Terre mais rarement à l’état pur car les atomes d’hydrogène sont presque toujours liés à d’autres comme l’oxygène dans l’eau (H2O) ou le carbone dans les hydrocarbures (HC) qui sont les deux sources principales d’hydrogène aujourd’hui. Et contrairement aux énergies primaires (charbon, pétrole…), l’hydrogène n’est pas une énergie en tant que telle mais un vecteur énergétique, tout comme l’électricité, servant à transporter de l’énergie produite par une source primaire (pétrole, uranium) jusqu’aux usagés.
L’hydrogène est une énergie prometteuse puisqu’aujourd’hui elle peut être produite à partir d’énergies propres, notamment les énergies renouvelables (solaire) et dans les industries du transport, du bâtiment et de l’électricité.
Une énergie propre
L’hydrogène permet de diversifier le mix énergétique et de s’affranchir de la dépendance aux ressources fossiles dont les réserves sont limitées et géographiquement concentrées, si les méthodes de productions employées n’émettent pas de CO2.
Utilisé dans une pile à combustible, l’hydrogène respecte l’environnement car ce vecteur d’énergie produit de l’électricité de façon propre et silencieuse et ne dégageant que de l’eau.
L’hydrogène étant un gaz léger, il peut être comprimé ou liquéfié afin de faciliter son transport et stockage. Cette transformation qui recourt à une quantité d’énergie importante peut s’avérer parfois polluante et émettrice de gaz à effet de serre.
Des méthodes de production spécifiques
Les deux principales méthodes de production d’hydrogène aujourd’hui sont :
- Le vaporeformage ou reformage à la vapeur, qui est le procédé de production de gaz de synthèse à partir de gaz naturel (essentiellement composé de méthane CH4), porté à une température s’élevant entre 700 et 1100 °C. La vapeur d’eau et le méthane réagissent en faisant une réaction dégageant du monoxyde de carbone (CO2) et de l’hydrogène (H2).
- L’électrolyse de l’eau (H2O), qui consiste à soumettre les molécules d’eau à un courant électrique, permettant sous forme de vapeur, de dissocier les molécules d’oxygène à celles d’hydrogène.
L’hydrogène a plusieurs dénominations aujourd’hui : elles se déclinent par couleur, faisant référence aux différentes méthodes de production de celui-ci (catalogue proposé par l’IRENA Agence internationale des énergies renouvelables).
En 2019, 75 millions de tonnes d’hydrogène ont été consommées dans le monde dont 90% est produit à partir d’énergies fossiles.
Les deux principaux fournisseurs d’hydrogène sont les Etats-Unis et la Chine, qui produisent respectivement environ 10 millions de tonnes/an.
A titre de comparaison, la France se trouve loin derrière avec 1 million de tonnes/an (1,5% de la production mondiale), utilisant principalement les hydrocarbures (40%), le gaz naturel (40%), le charbon (14%) et l’électrolyse (6%). Plus de la moitié de la consommation française d’hydrogène est destinée au raffinage (59%), plus d’un tiers à l’industrie de la chimie (26% ammoniac et engrais, 10% autres) et enfin 5% pour la métallurgie spatiale.
Dans le monde, l’hydrogène est également utilisé dans d’autres secteurs tels que le transport, le bâtiment ou encore la production d’électricité.
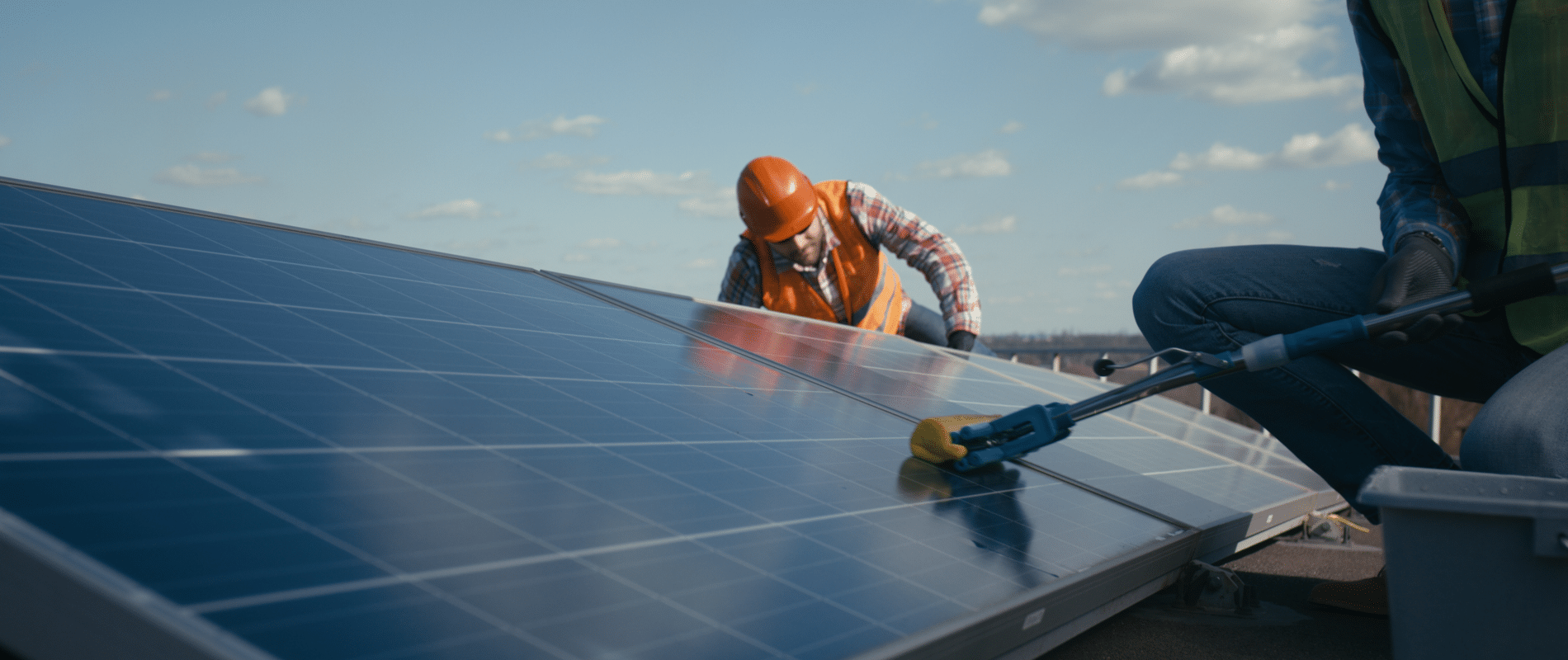
Des usages déjà en place avec un potentiel fort
Les usages se développent et s’accélèrent dans la mobilité
Le secteur des transports offre un potentiel de développement majeur au vecteur hydrogène : celui-ci peut être utilisé directement dans les moteurs à combustion interne ou dans des piles à combustible.
Dans le secteur automobile :
- Usages : 11 200 véhicules en 2018 (Californie, Europe et Japon)
~ 500 bus ~ 400 camions ~ 100 camionnettes en 2018, - Perspectives : Focus à venir sur les trajets long-courriers et de poids lourds,
- Avantages : Temps de ravitaillement court, moins de poids ajouté pour l’énergie stockée et zéro émission d’échappement,
- Freins : Coût du carburant élevé dû à la rareté des stations de ravitaillement, pertes d’efficacité, coût de vente d’une voiture onéreux (70 000 €)
Power-to-liquid : grande consommation d’électricité et coûts de production élevés.
Dans l’aéronautique :
- Usages : Limité à de petits projets expérimentaux et à des études de faisabilité,
- Perspectives : Forte croissance pour le mode de transport de passagers,
- Avantages : Grand volume de stockage et nouvelle conception pour l’hydrogène pur (notamment la Power-to-liquid et les biocarburants),
- Freins : Coût actuel qui est 4 à 6 fois plus cher que le kérosène, augmentation des prix.
Dans le secteur ferroviaire :
- Usages : Deux trains à hydrogène en Allemagne. Commande de 27 trains pour 2022 à Alstom pour la région de Francfort,
- Perspectives : Pilier du transport dans les pays les plus vastes (Chine, Russie, Australie…),
- Avantages : Temps de ravitaillement court, compétitif dans le fret ferroviaire (lignes régionales avec une faible utilisation du réseau et fret transfrontalier),
- Freins : Coût actuel de 30% plus cher qu’un train Diesel à cause des réservoirs d’hydrogène et de la pile à combustible.
Dans le secteur maritime :
- Usages : Limité aux projets expérimentaux pour les petits navires et l’alimentation électrique à bord des grands navires,
- Perspectives : L’activité de fret maritime devrait croître d’environ 45% d’ici 2030,
- Avantages : Décarbonisation des transports nationaux et répond à la stratégie de réduction des gaz à effet de serre de l’OMI (Organisation Maritime Internationale),
- Freins : Coût de stockage plus élevé, volume de fret perdu en raison du stockage (densité inférieure à celle des carburants liquides actuels).
Une vraie opportunité dans le développement d’autres secteurs : le bâtiment / production d’électricité et approvisionnement en chaleur dans le bâtiment
L’hydrogène permet de stocker durablement l’énergie et de répondre à l’intermittence de l’électricité tout en augmentant l’utilisation des énergies renouvelables (principalement photovoltaïque et éolien) dans le mix énergétique. En été, l’hydrogène permet de stocker le surplus d’électricité produit par des panneaux solaires dans des réservoirs sous forme gazeuse (dihydrogène).
L’hiver, lorsque les panneaux solaires ne produisent plus assez d’électricité, le surplus de dihydrogène stocké est converti en électricité grâce à une pile à combustion. 1 kilo de dihydrogène permet d’assurer la consommation d’électricité d’une famille de quatre personnes pendant 3 jours. Cependant, une maison de 100m² peut difficilement être alimentée exclusivement via des panneaux solaires car il leur faudrait 100m² de toiture pour couvrir leurs besoins en électricité.
Dans le secteur du bâtiment, l’hydrogène reste pour le moment une voie potentielle d’utilisation pour l’approvisionnement en chaleur des bâtiments. Des projets expérimentaux sont en cours comme le projet GRHYD lancé en France en 2017. Il propose de transformer en hydrogène, l’électricité non consommée, directement au moment de sa production. Il est ensuite injecté dans les réseaux de gaz naturel et permet d’utiliser ce gaz pour le chauffage ou la production d’eau chaude : c’est le concept du « Power to Gas ». Ce projet vise à valoriser l’électricité « verte » et maximiser la part des énergies renouvelables intégrée dans la consommation d’énergie française.
La filière hydrogène est prometteuse mais le marché reste jeune et de nombreux projets encore expérimentaux fleurissent dans la plupart des secteurs. Face aux nombreux freins que doit affronter la filière, une réglementation européenne en faveur de l’hydrogène et une entente entre les pays sont primordiales. Aujourd’hui, les technologies de l’hydrogène propres sont disponibles mais les coûts restent importants.
Conclusion
Le grand défi des prochaines années sera donc de stimuler la demande commerciale d’hydrogène propre en soutenant la R&D pour améliorer les performances actuelles en mettant en place des politiques gouvernementales de subvention de la filière pour rendre son prix attractif notamment pour les piles à combustible, les carburants à base d’hydrogène ou encore les électrolyseurs.
En 2020, le gouvernement a lancé son plan de relance pour l’hydrogène et ce n’est pas moins de 7 milliards d’euros d’ici à 2030, dont 2,4 milliards d’ici à 2023, pour créer une filière française de l’hydrogène décarbonée sur le plan international. Elle a pour objectif une économie de 6 millions de tonnes de CO2 par an dès 2030, soit l’équivalent des émissions annuelles de la ville de Paris.
Depuis 2010 Magellan accompagne les industriels et énergéticiens français dans leurs innovations et leurs transformations digitales.
Auteurs de la tribune
Point de vue de Frédéric LAMISSE, Gabrielle SCHAAL et Anne-Charlotte ROUSSELOT, consultant(e)s au sein du secteur Energie, Utilities de Magellan Consulting
Notre practice Energie & Utilities
Découvrez les offres et publications de notre équipe
Energies & Utilities
A propos de Magellan Consulting
Magellan Consulting est le catalyseur de la transformation digitale de ses clients en les accompagnant dans le changement profond de leurs métiers et de leurs socles technologiques pour aborder les nouveaux business modèles, la transition sociétale, énergétique et écologique.
